Esiste un diritto a decidere della propria morte?
Corte Europea Diritti dell'Uomo , sez. V, sentenza 19.07.2012 n° 497/09 (Riccardo Bianchini)
 Una toccante vicenda umana ha dato modo alla CEDU di esprimersi su un tema assai delicato sia per le rilevanti questioni giuridiche sottese che, soprattutto, per le implicazioni “culturali” che sono ad esso connesse.
Una toccante vicenda umana ha dato modo alla CEDU di esprimersi su un tema assai delicato sia per le rilevanti questioni giuridiche sottese che, soprattutto, per le implicazioni “culturali” che sono ad esso connesse.Il tema – già in passato trattato dalla Corte – è quello dell’esistenza di un diritto (qui inteso come posizione giuridica tutelata dall’ordinamento) a decidere della propria morte con conseguente obbligazione a carico dello Stato di non impedire tale evento. Il caso di specie è poi reso particolare dal ricorrere di due ulteriori elementi:
1) il ricorrente era il coniuge del morente, il quale ha invocato esso stesso, in proprio, la lesione alla sua sfera giuridica;
2) l’“accusa” mossa allo Stato di appartenenza, nello specifico la Repubblica Federale di Germania, riguarda un comportamento omissivo dello Stato stesso.
La Corte, dunque, oltre a ribadire il proprio orientamento, già espresso nella sentenza Pretty, ha affrontato la tematica della riconducibilità in capo al coniuge di un autonomo diritto a che la propria moglie, che ha espresso una inequivoca volontà in tal senso, possa conseguire una morte decorosa. Inoltre, come detto, nel caso di specie la pretesa dei due coniugi era quella di ottenere l’autorizzazione dal proprio Paese all’acquisto di un farmaco letale, in modo da evitare che la morente dovesse recarsi personalmente fuori dai confini dello Stato per effettuare il suicidio assistito: una pretesa, dunque, rivolta ad ottenere una (seppur indiretta) cooperazione nell’effettuazione del suicidio da parte dello Stato.
Per comprendere meglio la vicenda sembra opportuna una sintetica ricostruzione dei fatti di causa relativi allo svolgimento dei giudizi innanzi agli organi della giustizia interna.La moglie del ricorrente era affetta da una grave tetraplegia conseguente a un incidente domestico e, dunque, dopo alcuni anni di doloroso protrarsi dello stato di infermità – tale da richiedere la continua assistenza medica e la necessità di assistenza respiratoria – aveva deciso di porre fine alla propria vita, atteso che i medici stimavano in almeno quindici anni la sua speranza di vita in tali condizioni.
A tal fine, aveva richiesto all’apposito organo del Governo Federale di ottenere l’autorizzazione all’acquisto della quantità sufficiente di una sostanza capace di procurarne la morte (pentobarbital di sodio).
L’ente pubblico aveva rifiutato tale autorizzazione sul presupposto che la legislazione nazionale era contraria, nelle proprie finalità, a che fosse consentito l’acquisto di una data sostanza per porre fine alla propria vita. I due coniugi avevano dunque proposto ricorso amministrativo avverso tale diniego, ma prima che la decisione di merito giungesse, la donna, accompagnata dal marito, si era fatta trasportare per un lungo e doloro viaggio verso la Svizzera, in cui aveva potuto effettuare il suicidio assistito.
A fronte di ciò, tutti i gradi di giudizio interno percorsi dal ricorrente si concludevano, nella sostanza, con pronunce di rito, sul presupposto che con la morte del coniuge ogni interesse alla prosecuzione del giudizio sarebbe venuto meno.
Questo perché, da un lato, la coniuge aveva comunque ottenuto il suicidio e, dall’altro, non sarebbe comunque ascrivibile in capo al marito alcuna posizione giuridica protetta. Inoltre, il giudice interno manifestava in un obiterdictum la propria contrarietà riguardo alla configurabilità di estrarre dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo a porre fine alla propria vita.
La CEDU, esaminando il caso, ha invece accolto il ricorso del marito.
Essa, ha dapprima rigettato la domanda del ricorrente volta a far valere le pretese della moglie deceduta, in quanto si tratterebbe di una pretesa non suscettibile di essere azionata da parte di un famigliare.
La Corte, come anticipato, ha accolto invece la domanda autonoma sollevata dal ricorrente, per la lesione ai suoi stessi diritti.
Per fare ciò, innanzitutto la Corte conferma quanto già stabilito nella pronuncia Pretty, ossia che dall’art. 8 della Convenzione, che tutela il diritto alla vita privata, è ricavabile anche il diritto alla non prosecuzione di una vita in modo ritenuto degno. Questo perché, secondo la Corte, pur senza negare la sacralità del diritto alla vita protetto dalla stessa Convenzione, deve ritenersi che in un’epoca in cui la sempre maggiore capacità tecnologica di aumentare la speranza di vita consente di sopravvivere a molti che si trovano infermianche se essi non riuscirebbero con le proprie forze a sopravvivere, tale condizione di vita potrebbe risultare esattamente agli antipodi rispetto alla concezione di vita fatta propria dall’infermo. Su tale ragionamento, nella precitata pronuncia Pretty, la Corte aveva quindi affermato che non può escludersi che costituisca una lesione al diritto al rispetto della propria vita privata di cui all’art. 8 della Convenzione una legge che impedisca di scegliere di porre fine ad una vita che si protrae in condizioni ritenute indegne e penose.
Ora, nel caso di specie, la Corte non è entrata nel merito della violazione dell’art. 8 nei termini sopra esposti, e non ha dunque affrontato il tema della violazione di tale disposizione per l’ipotesi specifica del caso concreto.Infatti, come sopra accennato, la pretesa della morente e del coniuge, in questo caso, era quella di vedersi autorizzati all’acquisto di un farmaco al fine di evitare il doloro (e costoso) “viaggio della morte” verso i confini dello Stato svizzero.
La Corte si è però limitata a constatare che con le pronunce di irricevibilità dei giudici interni era stata negata la possibilità di richiedere giustizia al ricorrente e, pertanto, riconoscendo che nel caso di specie il coniuge vantava un proprio diritto alla proposizione della domanda, la Corte ha statuito che è stata violata la disposizione di cui all’art. 13 della Convenzione, recante la protezione della possibilità di proporre un “ricorso effettivo” a tutela dei diritti riconosciuti dalla Convenzione nell’ambito delle giurisdizioni nazionali.
Di contro, sul merito della questione, la Corte ha constatato come in diritto comparato soltanto quattro Stati prevedono una effettiva protezione del diritto a porre fine alla propria vita, prevedendo l’istituto del suicidio assistito, mentre la maggioranza dei paesi ha una legislazione tale per cui, per essendo lecito il suicidio, costituisce un reato l’assistenza attiva nell’effettuazione dello stesso.Da ciò la constatazione che, ferma restando la violazione procedimentale insita nel fatto che con le dichiarazioni di irricevibilità i giudici interni hanno negato la possibilità di proporre un ricorso effettivo, dovrà essere lo Stato stesso a dare una risposta alla domanda di giustizia (risposta, beninteso, che coinvolga il merito della questione e che non si limiti ad aspetti procedurali già superati da questa pronuncia).
(Altalex, 20 agosto 2012. Nota di Riccardo Bianchini)
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Sezione V
Sentenza 19 luglio 2012, n. 497/09
Ancienne cinquième sectionAFFAIRE K. c. ALLEMAGNE
(Requête no 497/09)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies par l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire K. c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne cinquième section)
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 novembre 2010 et 26 juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 497/09) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat2. Le requérant a été représenté par Me D. K.
3. Le requérant alléguait que le refus d’autoriser sa défunte épouse à se procurer une dose létale de médicaments pour lui permettre de mettre fin à ses jours avait porté atteinte au droit de celle-ci
4. Une chambre de la cinquième section a décidé le 11 septembre 2009 de communiquer la requête au gouvernement défendeur. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
Mme A. Wittling-Vogel
M. C. Walter
M. M. Indenhuck
Mme V. Weissflog
M. V. Giesler
– pour le requérant
M. D. K.
Le requérant était également présent à l’audience.
La Cour a entendu MM. K. et Walter en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions qui leur ont été posées.
5. Par une décision du 31 mai 2011
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). Des observations ont également été reçues de Dignitas, une association de droit privé suisse dont le but est d’assurer à ses membres une vie et une mort respectant la dignité humaine, représentée par M. L. A. Minelli, et de Aktion Lebensrecht für alle e. V. (AlfA), une association de droit allemand vouée à la protection de la vie humaine de la conception à la mort naturelle, représentée par Alliance Defense Fund, lui-même représenté par Me R. Kiska, conseil. Ces associations avaient été autorisées à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement).
EN FAIT
I. Les circonstances de l’espèce7. Le requérant est né en 1943 et réside à Braunschweig.
8. Le requérant et sa défunte épouse, née en 1950, entamèrent leur vie commune en 1978 et se marièrent en 1980. Depuis 2002, la défunte épouse du requérant souffrait d’une tétraplégie complète sur le plan moteur après être tombée dans les escaliers à son domicile. Presque complètement paralysée, elle était sous assistance respiratoire et avait besoin d’une surveillance et de soins médicaux constants. Elle souffrait également de spasmes. Selon l’appréciation des médecins, son espérance de vie était d’au moins encore quinze ans. Elle exprima le souhait de mettre un terme à ce qui était, à ses yeux, une vie indigne en se donnant la mort avec l’aide du requérant. Le couple contacta l’organisation suisse d’assistance au suicide, Dignitas, en vue de bénéficier d’une aide à cet égard.
9. En novembre 200410. Le 16 décembre 2004
11. Le 14 janvier 2005
12. En février 2005
13. Le 3 mars 2005, l’Institut fédéral confirma son refus antérieur. Dans sa décision, il exprimait en outre des doutes sur la question de savoir si l’on pouvait tirer de l’article 8 un droit reconnu par l’Etat pour un individu de se suicider. Quoi qu’il en soit, l’article 8 ne pouvait d’après lui s’interpréter comme imposant une obligation à l’Etat de faciliter un suicide médicamenteux en accordant l’autorisation à la personne concernée d’acquérir la dose létale de médicaments nécessaire. Par ailleurs, l’Institut fédéral estimait que pareil droit ne cadrait pas avec les principes supérieurs consacrés par l’article 2 § 2 de la Loi fondamentale allemande (voir la partie « droit interne pertinent » ci-dessous), qui consacrait l’obligation « exhaustive » de l’Etat de protéger la vie, notamment en refusant d’autoriser les personnes à se procurer une dose létale d’un médicament aux fins de commettre un suicide.
14. Enfin15. Le 4 avril 2005
16. Le 21 février 2006, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Cologne déclara l’action du requérant irrecevable. Il estimait que l’intéressé n’avait pas qualité pour agir puisqu’il ne pouvait prétendre être victime d’une violation de ses propres droits. En conséquence, selon le tribunal, le refus de l’Institut fédéral d’accorder à sa femme l’autorisation d’obtenir une dose médicamenteuse létale n’avait pas porté atteinte au droit de l’intéressé à la protection de son mariage et de sa vie familiale tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Loi fondamentale (Grundgesetz – voir la partie « droit interne pertinent » ci-dessous). Toute autre interprétation équivaudrait à affirmer qu’une atteinte aux droits d’un époux constituerait automatiquement aussi une atteinte aux droits de l’autre conjoint, affirmation qui, selon le tribunal, aurait pour effet d’éliminer la séparation entre les personnalités juridiques de chacun des époux, ce qui n’était manifestement pas le but de l’article 6 § 1 de la Loi fondamentale. Le tribunal estimait en outre que les décisions contestées n’avaient pas porté atteinte au propre droit du requérant au respect de sa vie familiale au regard de l’article 8 de la Convention, puisqu’elles n’avaient pas affecté les modalités de la vie commune du requérant et de son épouse.
17. Par ailleurs, selon le tribunal, le requérant ne pouvait pas se fonder sur les droits de son épouse puisque le droit d’acquérir la dose requise de médicaments était un droit de nature éminemment personnelle et non transférable. De plus18. Enfin
19. Le 22 juin 2007
20. Le 4 novembre 2008
II. Le droit et la pratique interne pertinents
A. La Loi fondamentale
21. L’article 6 § 1 de la Loi fondamentale dispose que le mariage et la famille bénéficient de la protection spéciale de l’Etat.
Aux termes de l’article 2 § 2 de la Loi fondamentale
La Cour constitutionnelle fédérale admet une protection posthume de la dignité humaine dans les cas où l’image de la personne décédée est compromise aux yeux de la postérité par ostracisme
B. La loi sur les narcotiques
22. La loi sur les narcotiques régit le contrôle des narcotiques. Trois annexes à la loi énumèrent les substances qui sont considérées comme des médicaments
Selon l’article 4 § 1
Conformément à l’article 5 § 1
Les médecins ne peuvent prescrire du pentobarbital sodique que si l’usage externe ou interne de cette substance est justifiée (article 13 § 1
C. Les dispositions régissant les devoirs des médecins à l’égard des patients en fin de vie
1. Responsabilité pénale
23. L’article 216 du code pénal se lit ainsi :
Homicide à la demande de la victime homicide par compassion
« Si une personne est amenée à commettre un homicide à la demande expresse et solennelle de la victimeToute tentative de ce type est passible de sanctions. »
Le suicide commis de manière autonome n’est pas pénalement sanctionné en droit allemand. Il s’ensuit que l’assistance à un suicide autonome ne tombe pas sous l’empire de l’article 216 du code pénal et n’est pas passible de sanctions. Toutefois
Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (voir
2. Règles professionnelles destinés aux médecins
24. Les codes de conduite professionnelle sont rédigés par les associations de médecins sous le contrôle des autorités sanitaires. Ces codes s’inspirent largement du code professionnel modèle destiné aux médecins allemands
Assistance aux personnes en fin de vie
« Les médecins peuvent – en donnant la priorité à la volonté du patient – s’abstenir de dispenser des mesures visant à prolonger la vie et se limiter à atténuer les symptômes seulement si le report d’une mort inévitable constituerait simplement une prolongation inacceptable des souffrances de la personne en fin de vie.Les médecins ne doivent pas abréger activement les jours d’une personne en fin de vie. Ils ne peuvent pas placer leurs propres intérêts ou les intérêts de tierces parties au-dessus du bien-être du patient. »
Les violations du code de conduite professionnelle sont sanctionnées par des mesures disciplinaires dont la plus grave est le retrait de l’autorisation de pratiquer la médecine.
Eu égard aux demandes d’assistance au suicide par des médecins
III. documents pertinents du Conseil de l’Europe
25. Les passages pertinents de la résolution 1418(1999) du Conseil de l’Europe se lisent ainsi :
« 9. L’Assemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres d’encourager les Etats membres du Conseil de l’Europe à respecter et à protéger la dignité des malades incurables et des mourants à tous égards:
a. en consacrant et en protégeant le droit des malades incurables et des mourants à une gamme complète de soins palliatifs
(...)
b. en protégeant le droit des malades incurables et des mourants à l’autodétermination
(...)
iii. pour qu’aucun malade incurable ou mourant ne reçoive de traitement contre sa volonté
iv. pour faire respecter les instructions ou la déclaration formelle («living will») rejetant certains traitements médicaux données ou faite par avance par des malades incurables ou des mourants désormais incapables d’exprimer leur volonté. (...) ;
v. pour que
vi. pour qu’en l’absence d’instructions anticipées ou de déclaration formelle il ne soit pas porté atteinte au droit à la vie du malade. Il convient de dresser la liste des traitements qui ne peuvent en aucun cas être refusés ou interrompus;
c. en maintenant l’interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants:
i. vu que le droit à la vie
ii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d’un tiers;
iii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l’exécution d’actions destinées à entraîner la mort. (...) »
IV. Droit comparé
26. Des recherches en droit comparé menées relativement à 42 Etats membres du Conseil de l’Europe montrent que, dans 36 pays (Albanie, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint Marin, Espagne, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie et Ukraine), toutes les formes d’assistance au suicide font l’objet d’une interdiction stricte et sont érigées en infractions pénales. En Suède et en Estonie, l’assistance au suicide ne constitue pas une infraction pénale toutefois, les médecins estoniens n’ont pas le droit de prescrire un médicament en vue de faciliter le suicide. A l’inverse, seuls quatre Etats (Suisse, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) autorisent leurs médecins à prescrire des doses létales de médicament, dans les limites de garanties particulières (Haas c. Suisse, no 31322/07, §§ 30-31 et 55, 20 janvier 2011).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES DROITS DU REQUÉRANT SOUS L’ANGLE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION27. Le requérant allègue que le refus des juridictions nationales d’examiner au fond son grief relatif au refus de l’Institut fédéral d’accorder à sa défunte épouse l’autorisation d’obtenir une dose létale de pentobarbital sodique a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en vertu de l’article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui
A. Existence d’une ingérence dans les droits du requérant au titre de l’article 8
1. Observations du Gouvernement
28. Le Gouvernement estime qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits reconnus aux requérants par l’article 8 de la Convention. Selon lui
29. Le Gouvernement ne conteste pas le fait que le requérant ait été émotionnellement affecté par le suicide de son épouse et les circonstances entourant le décès de celle-ci. Certes
30. Le Gouvernement observe que
31. Le Gouvernement considère en outre que le requérant ne peut prétendre qu’une décision sur la requête présentait un intérêt général
32. Pour le Gouvernement
33. Le Gouvernement souligne que la Cour
34. Selon le Gouvernement
2. Observations du requérant
35. Le requérant soutient que les décisions des instances internes ont porté atteinte à ses propres droits au regard de l’article 8 de la Convention. Tant l’Institut fédéral que les juridictions nationales n’ont pas estimé que la décision sur la demande de sa défunte épouse présentait pour lui un intérêt personnel
36. Le requérant souligne que son épouse a été empêchée de mettre fin à ses jours dans l’intimité de son foyer
37. En l’espèce
38. Le requérant observe que
39. Pour le requérant
3. Observations des tierces parties
a) Dignitas
40. Dignitas soutient que la décision d’une personne de décider de la manière de mettre fin à ses jours fait partie du droit à l’autodétermination protégé par l’article 8 de la Convention. Un Etat contractant devrait se borner à réglementer le droit d’un individu de décider en toute indépendance du moment ou des modalités de sa mort en vue de prévenir les actions hâtives et inconsidérées. Dans la mesure où les associations travaillant dans ce domaine ont déjà mis des mécanismes préventifs en place
b) AlfA
41. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour
42. En outre
4. Appréciation de la Cour
43. La Cour observe d’emblée qu’à son sens, l’exception du Gouvernement concernant la qualité de victime du requérant soulève la question de savoir s’il y a eu atteinte aux propres droits du requérant au titre de l’article 8 de la Convention. Elle relève que le requérant soutient que les souffrances de l’épouse et les circonstances finales de son décès l’ont affecté, en sa qualité de mari compatissant et de soignant, au point d’emporter violation de ses propres droits en vertu de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la présente espèce doit être distinguée d’affaires portées devant la Cour par un héritier ou un parent de la personne décédée au nom de celle-ci. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de déterminer dans ce contexte si le droit issu de la Convention invoqué par le requérant était de nature à être transféré de la victime immédiate à son successeur légal (comparer à cet égard avec Sanles Sanles, arrêt précité)
44. Malgré ces différences45. a) la Cour relève d’emblée que le requérant et B.K. étaient mariés depuis 25 ans au moment où cette dernière a demandé à être autorisée à acquérir le médicament létal. Il ne fait aucun doute que le requérant entretenait une relation très étroite avec sa défunte épouse.
b) le requérant a de plus établi qu’il avait accompagné sa femme pendant toutes ses souffrances
c) l’implication personnelle du requérant est en outre démontrée par le fait qu’il a présenté un recours administratif conjointement avec son épouse et qu’il a poursuivi la procédure interne en son propre nom après le décès de celle-ci. Dans ces circonstances exceptionnelles
46. La Cour observe de plus que la présente espèce soulève des questions fondamentales tenant au souhait d’un patient de décider lui-même de mettre fin à ses jours
47. La Cour en vient finalement à l’argument du Gouvernement selon lequel il n’est pas utile de reconnaître au requérant le droit de poursuivre l’action entreprise par sa femme puisque B.K. aurait pu attendre l’issue de la procédure devant les juridictions internes et accélérer celle-ci en demandant des mesures provisoires. La Cour observe que le requérant et B.K. ont présenté conjointement un recours administratif le 14 janvier 2005. Le 12 février 2005
48. Quant aux observations du Gouvernement selon lesquelles B.K. aurait pu demander des mesures provisoires afin d’accélérer la procédure
49. Quand bien même les juridictions internes auraient accéléré le traitement de la demande de B.K. si celle-ci avait toujours été en vie pendant la procédure
50. Eu égard aux considérations ci-dessus
51. La Cour rappelle que la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive (voir, notamment, Pretty, arrêt précité, § 61). Dans l’arrêt Pretty, la Cour a établi que la notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de l’article 8 de la Convention (Pretty, ibidem). Sans nier en aucune manière le principe du caractère sacré de la vie protégé par la Convention, la Cour a considéré que, à une époque où l’on assiste à une sophistication médicale croissante et à une augmentation de l’espérance de vie, de nombreuses personnes redoutent qu’on ne les force à se maintenir en vie jusqu’à un âge très avancé ou dans un état de grave délabrement physique ou mental aux antipodes de la perception aiguë qu’elles ont d’elles-mêmes et de leur identité personnelle (Pretty, arrêt précité, § 65). En conclusion, la Cour a déclaré ne pouvoir « exclure que le fait d’empêcher par la loi la requérante d’exercer son choix d’éviter ce qui, à ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible représente une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention » (Pretty, arrêt précité, § 67).
52. Dans l’affaire Haas c. Suisse, la Cour a encore précisé cette ligne de jurisprudence en reconnaissant que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence, était l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention (Haas, arrêt précité, § 51). Elle a conclu que, même à supposer que les Etats eussent une obligation positive d’adopter des mesures permettant de faciliter la commission d’un suicide dans la dignité, les autorités suisses n’avaient pas méconnu cette obligation en l’espèce (Haas, arrêt précité, § 61).
53. La Cour a en outre estimé que l’article 8 de la Convention pouvait impliquer un droit à un contrôle juridictionnel même dans une affaire où le droit matériel en question restait à établir (Schneider c. Allemagne54. Eu égard aux considérations ci-dessus
B. Observation de l’article 8 de la Convention
55. La Cour se propose donc d’examiner si les droits propres du requérant au titre de l’article 8 de la Convention ont été suffisamment préservés au cours de la procédure interne.1. Observations du Gouvernement
56. Pour le Gouvernement
57. Même en admettant que l’article 8 de la Convention pût imposer à un Etat l’obligation de simplifier l’acquisition d’un médicament spécifique en vue de faciliter un suicide, le Gouvernement estime que le refus de l’Institut fédéral se justifiait sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8. Selon lui, la décision trouvait une base légale dans les dispositions pertinentes de la loi sur les narcotiques et poursuivait le but légitime de protéger la santé et le droit à la vie. Quant à la question de savoir si la décision était nécessaire dans une société démocratique, le Gouvernement revendique une ample marge d’appréciation, considérant en particulier que la situation juridique en la matière varie considérablement d’un Etat membre à l’autre. Il renvoie de plus à la dimension éthique de la question de savoir si et dans quelle mesure l’Etat doit faciliter ou soutenir le suicide, ce qui est démontré par le fait que les questions en jeu ont été examinées par le Comité d’éthique national (Nationaler Ethikrat). Enfin, l’importance fondamentale attachée par l’ordre juridique allemand à la protection de la vie contre la mise en œuvre de l’euthanasie se fonderait sur de profondes raisons historiques, qui auraient conduit à une notion juridique de la dignité humaine particulièrement forte.
58. Le Gouvernement souligne en outre que B.K. disposait d’autres possibilités pour mettre fin à ses jours sans douleur. En particulier59. Le Gouvernement affirme qu’il appartient essentiellement aux autorités nationales d’apprécier les risques inhérents au fait d’octroyer un libre accès à des médicaments. A ses yeux
En résumé
2. Observations du requérant
60. Le requérant soutient que les juridictions nationales
61. La décision prise par l’Institut fédéral ne poursuivait selon lui aucun but légitime et n’était pas nécessaire au sens du paragraphe 2 de l’article 8. La dose létale de médicament réclamée par l’épouse du requérant aurait été nécessaire pour permettre à celle-ci de s’éteindre sans douleur et dans la dignité à son domicile. D’après le requérant, son épouse ne disposait d’aucun autre moyen lui permettant de se suicider à son domicile. En particulier, les règles pertinentes n’auraient pas permis à B.K. de mettre fin à ses jours par l’interruption d’un traitement palliatif avec l’assistance d’un médecin, puisqu’elle ne se trouvait pas en phase terminale au moment où elle a décidé de se suicider. Le requérant remarque que la loi pertinente à cet égard était et est toujours peu claire et permettait uniquement l’interruption de traitements palliatifs pour les patients souffrants d’une maladie incurable.
62. Le requérant admet qu’un contrôle est nécessaire afin de prévenir le recours abusif à des substances létales. Cependant3. Observations des tierces parties
63. Dignitas estime que les exigences stipulées dans l’arrêt Artico de la Cour (précité) ne pourraient être remplies que si le pentobarbital sodique était mis à la disposition des personnes souhaitant se suicider et si
64. Pour AlfA
4. Appréciation de la Cour
65. La Cour se propose de commencer son examen par le volet procédural de l’article 8. Elle observe tout d’abord que le tribunal administratif et la cour d’appel administrative ont refusé d’examiner au fond la demande du requérant
66. La Cour conclut que les juridictions administratives – nonobstant l’obiter dictum du tribunal de première instance – ont refusé d’examiner le fond de la demande présentée initialement par B.K. devant les autorités nationales.
67. La Cour observe de plus que le Gouvernement n’a pas soutenu que le refus d’examiner le fond de la cause poursuivait un quelconque but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article 8. La Cour ne voit pas davantage en quoi l’ingérence dans le droit du requérant pouvait servir l’un ou l’autre des buts légitimes énumérés dans ledit paragraphe.
68. Il s’ensuit qu’il y a eu violation du droit du requérant au titre de l’article 8 de voir sa demande examinée au fond par les juridictions internes.
69. Quant au volet matériel du grief tiré de l’article 8
70. La Cour estime que ce principe est d’autant plus pertinent que le grief concerne une question pour laquelle les Etats jouissent d’une importante marge d’appréciation. Les recherches en droit comparé montrent que la majorité des Etats membres n’autorisent aucune forme d’assistance au suicide (paragraphe 26 ci-dessus et Haas, arrêt précité, § 55). Seuls quatre des Etats étudiés autorisent les médecins à prescrire une dose létale de médicaments afin de permettre à un patient de mettre fin à ses jours. Partant, les Etats parties à la Convention sont loin d’avoir atteint un consensus à cet égard, ce qui implique de reconnaître à l’Etat défendeur une marge d’appréciation considérable dans ce contexte (Haas, arrêt précité, § 55).
71. Eu égard au principe de subsidiarité72. Il découle de ce qui précède que le refus des juridictions internes d’examiner au fond la demande du requérant a emporté violation du droit de celui-ci au respect de sa vie privée au regard de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DU DROIT RECONNU A L’EPOUSE DU REQUÉRANT PAR L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
73. La Cour rappelle que
A. Observations du Gouvernement
74. Invoquant la décision de la Cour en l’affaire Sanles Sanles (précitée)75. Pour le Gouvernement
B. Observations du requérant
76. Pour le requérant77. Il juge décisif le fait que lui-même et son épouse ont conjointement présenté un recours administratif contre la décision de l’Institut fédéral. Après la mort de son épouse
C. Appréciation de la Cour
78. La Cour rappelle que79. La Cour a confirmé le principe voulant que les droits tirés de l’article 8 soient de nature non transférable et ne puissent donc être revendiqués par un parent proche ou un autre héritier de la victime immédiate dans les affaires Thévenon c. France ((déc.)
80. La Cour réitère que « [sans qu’elle] soit formellement tenue de suivre ses arrêts antérieurs
81. Pour la Cour, les arguments présentés ne suffisent pas pour qu’elle en vienne à se démarquer de sa jurisprudence établie, qu’elle a passée en revue en l’espèce. Dès lors
82. En application de l’article 35 § 4 in fine de la Convention
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DU DROIT D’ACCÈS DU REQUÉRANT A UN TRIBUNAL
83. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention
84. Dans sa décision sur la recevabilité
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
85. Aux termes de l’article 41 de la Convention
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles
A. Dommage
1. Dommage moral86. Le requérant réclame une somme globale de 5 000 euros (EUR) pour le dommage moral relatif à la douleur subie par son épouse et à ses souffrances additionnelles due à l’extension non voulue par elle de sa vie
87. Le Gouvernement estime que le requérant et son épouse se sont inutilement exposés à des souffrances additionnelles
88. La Cour a conclu ci-dessus que le requérant ne pouvait se plaindre d’une violation des droits reconnus par la Convention à sa défunte épouse. Dès lors
2. Dommage matériel
89. S’appuyant sur plusieurs documents
90. Pour le Gouvernement
91. La Cour estime qu’il convient d’examiner les frais afférents à la procédure de recours administratif sous la rubrique des « frais et dépens ». Quant au reste des prétentions du requérant
B. Frais et dépens
92. Le requérant93. Le Gouvernement exprime des doutes quant au caractère nécessaire et approprié de la somme réclamée. Il souligne en outre que le requérant n’a pas soumis d’accord écrit sur le taux horaire qu’il prétend avoir payé.
94. Selon la jurisprudence de la Cour
C. Intérêts moratoires
95. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare irrecevable le grief du requérant concernant la violation des droits reconnus par la Convention à l’épouse de l’intéressé 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en ce que les juridictions nationales ont refusé d’examiner au fond la demande du requérant
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation du droit d’accès du requérant à un tribunal sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention
4. Dit :
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant
i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros)
ii. 26 736
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais et en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2012
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
estratto da: http://www.altalex.com/index.php?idnot=58431



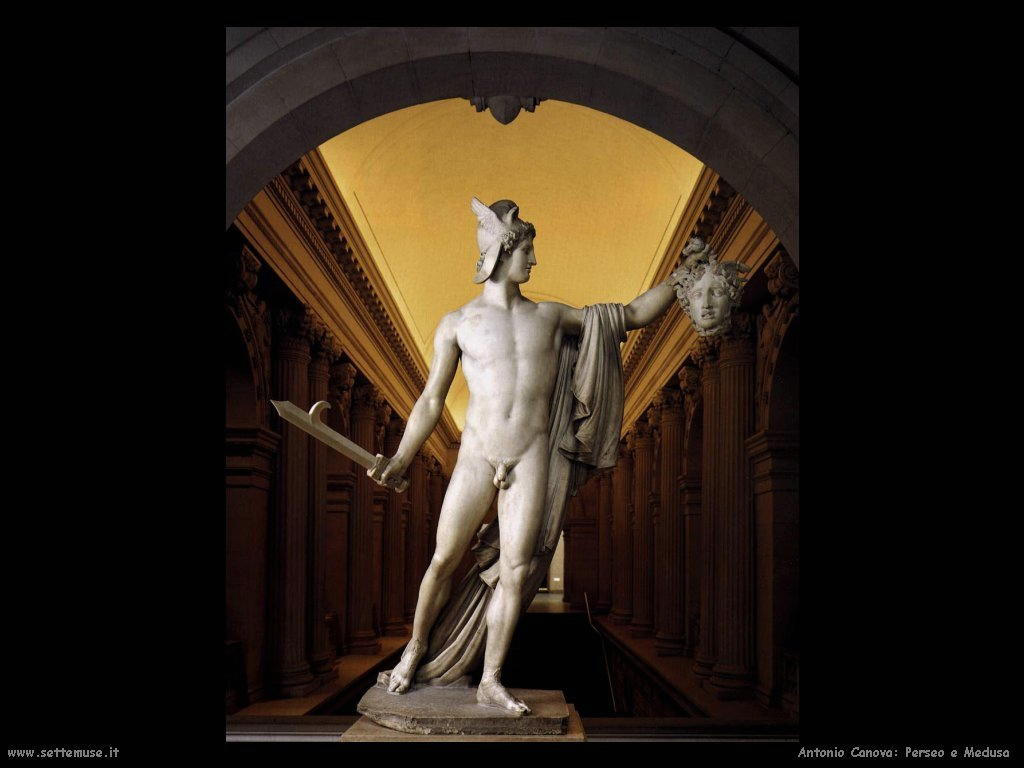

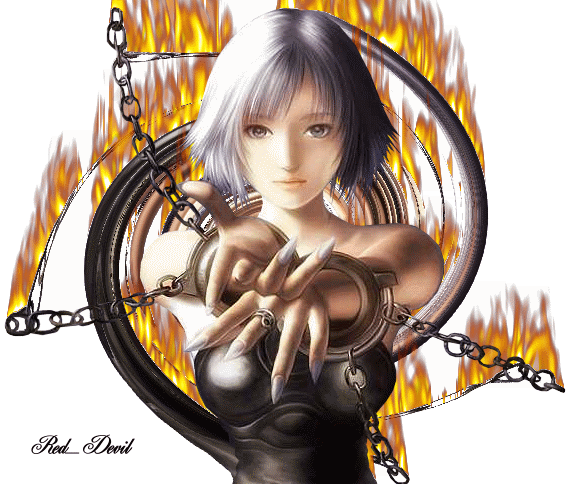
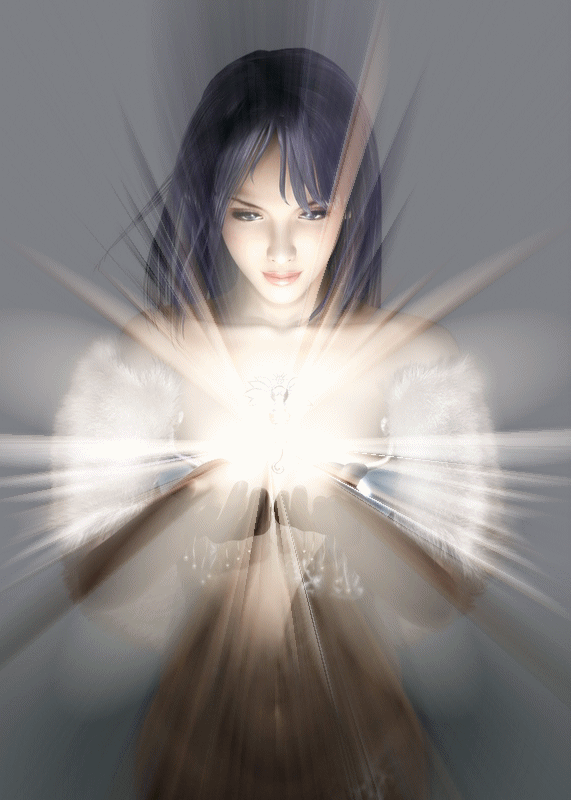
Nessun commento:
Posta un commento